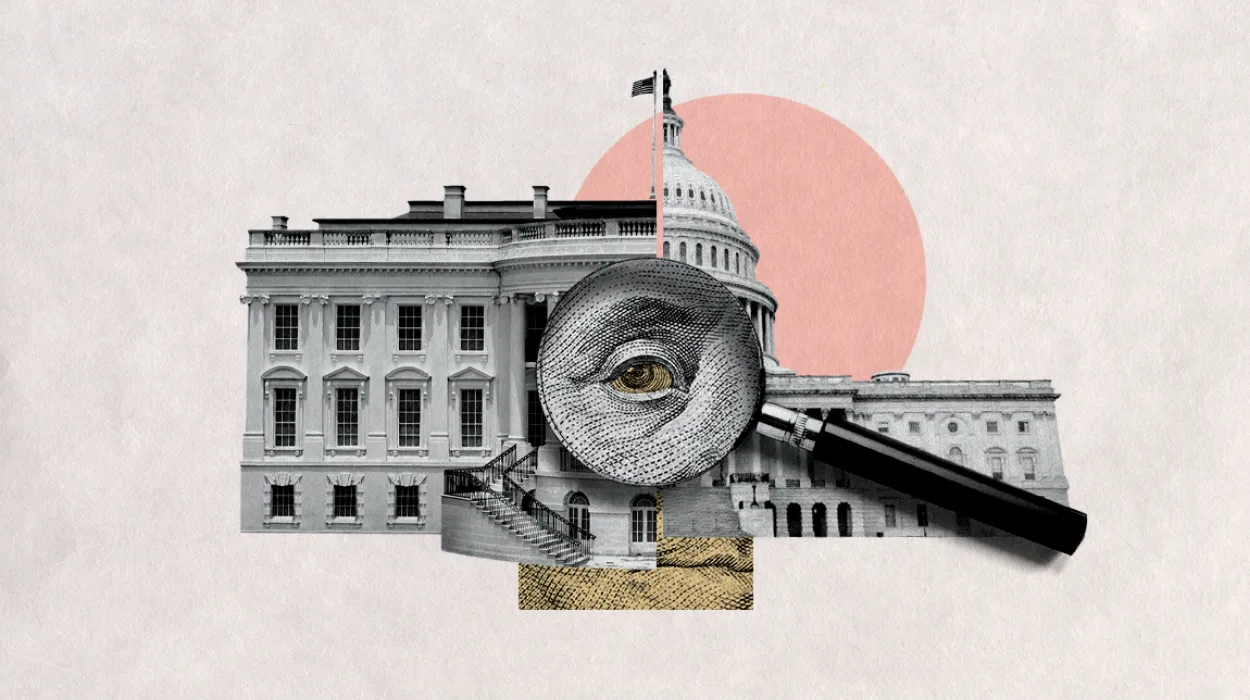En 2025, la confiance envers les institutions gouvernementales atteint un niveau historiquement bas dans plusieurs pays démocratiques. Aux États-Unis, seuls 22 à 33 % des citoyens déclarent faire confiance au gouvernement fédéral pour agir dans l’intérêt public la plupart du temps.
La baisse est particulièrement marquée chez les jeunes : seulement 15 % des 18 à 34 ans déclarent avoir une grande confiance envers une quelconque institution fédérale. Un mélange de blocages politiques, de corruption perçue, de désinformation et d’opacité administrative a alimenté cette érosion. La transparence – c’est-à-dire la divulgation opportune, accessible et vérifiable des actions et informations gouvernementales – est devenue un outil essentiel pour restaurer cette confiance perdue. Elle permet de rendre les responsables publics imputables en montrant clairement comment sont prises les décisions et comment l’argent est dépensé.
La transparence comme fondement de la confiance
Selon des données à paraître mi-2025 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seulement 39 % des citoyens des États membres font modérément ou fortement confiance à leur gouvernement national. Cette moyenne masque d’importantes disparités : la confiance est plus élevée dans les pays nordiques, tandis qu’elle est plus faible en Europe du Sud et de l’Est. Il existe une corrélation positive entre confiance, transparence et intégrité du service public.
De nombreux pays ont adopté des lois sur la transparence – telles que les lois sur l’accès à l’information et les lois anticorruption – mais leur mise en œuvre est inégale. Par exemple, seuls 42 % des pays de l’OCDE publient les déclarations de patrimoine des hauts responsables, et encore moins divulguent les salaires de manière exhaustive. Ces écarts entre politique et pratique nuisent à la confiance du public dans les mécanismes de responsabilité gouvernementale.
Transparence et cohésion sociale
La transparence des institutions publiques favorise la participation civique et l’adhésion aux politiques. Lorsque les raisons et les données qui sous-tendent les décisions – comme les réformes fiscales ou les mesures sanitaires – sont expliquées clairement, les citoyens sont plus enclins à les accepter. Ainsi, la transparence ne renforce pas seulement la confiance, mais aussi la cohésion sociale et la résilience démocratique.
Le rôle de la transparence dans la responsabilité et la qualité de la gouvernance
La transparence contribue directement à renforcer la responsabilité. Elle permet aux citoyens, à la société civile et aux institutions de contrôle d’exercer une véritable surveillance. Un sondage mené en 2025 par le Partnership for Public Service a révélé que 69 % des Américains considèrent leur gouvernement fédéral comme corrompu ou inefficace. Que cette perception soit fondée ou non, elle nuit fortement à la légitimité démocratique et au moral civique.
Les systèmes de transparence performants incluent : des données budgétaires ouvertes, des systèmes de marchés publics transparents, et des tableaux de bord de suivi de projets en temps réel. Ces outils permettent de détecter les inefficacités, de prévenir la fraude, d’améliorer la qualité des services publics, tout en renforçant les normes éthiques dans l’administration publique.
Les plateformes numériques comme moteurs de l’ouverture gouvernementale
La numérisation a profondément transformé la capacité des gouvernements à fournir aux citoyens des informations fiables et en temps utile. Des dépenses liées aux aides pandémiques aux investissements dans les infrastructures, des portails de transparence, des bibliothèques de contrats et des tableaux de bord interactifs permettent un suivi détaillé.
Le dernier Plan pour un gouvernement ouvert du Département du Trésor américain, publié en avril 2025, inclut de nouvelles visualisations budgétaires et des bases de données d’appels d’offres mises à jour en temps réel. De même, l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures (CISA) a renforcé son initiative contre la désinformation afin de préserver l’intégrité de l’information et la confiance du public dans les messages gouvernementaux.
Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à faire de la transparence non pas une option, mais une norme – avec une divulgation proactive et systématique, plutôt que réactive et sélective.
Points de vue des acteurs sur la transparence et la confiance
Transparency International soutient que la transparence doit être intégrée comme une norme culturelle dans les systèmes de gouvernance, au-delà du simple respect des règles. Cela nécessite un leadership fort, des institutions indépendantes et des formes de participation citoyenne. Leur rapport de 2025 souligne que rendre l’information disponible ne suffit pas si elle n’est ni exacte, ni accessible, ni compréhensible pour les citoyens.
L’Open Government Partnership (OGP), une organisation internationale de lobbying pour la réforme de la transparence, est fermement convaincu que l’accès aux ordinateurs et la protection garantie par la législation doivent s’accompagner de formations, d’éducation civique et de protection des journalistes d’investigation et des lanceurs d’alerte.
Perceptions locales vs fédérales de la transparence
Il est notable que les institutions locales bénéficient d’un niveau de confiance plus élevé que les institutions fédérales. En 2025, plus de 50 % des citoyens américains expriment leur confiance envers les responsables locaux. Cela pourrait s’expliquer par une présence plus visible et une réactivité perçue comme plus grande à l’échelle locale, ainsi que par des mécanismes de participation communautaire plus directs. Les institutions nationales gagneraient à s’inspirer des initiatives locales et à adopter des approches ascendantes.
Tendances statistiques de la transparence en 2025
Le mouvement mondial pour la transparence a progressé de manière mesurable en 2025. Les portails de transparence et les services publics numériques ont augmenté de 30 % depuis 2023, grâce à une demande croissante des citoyens et à des avancées technologiques dans l’infrastructure des données ouvertes.
Dans le secteur judiciaire, les données de l’OCDE indiquent un niveau de confiance moyen de 54 %, soit plus que pour les institutions politiques. Les pays qui publient les décisions judiciaires et maintiennent des archives juridiques publiques obtiennent de meilleurs scores en matière d’État de droit et de faibles indices de corruption.
En outre, les pays dotés de régimes de transparence plus solides affichent des taux de satisfaction citoyenne plus élevés. L’accès public aux contrats de marchés, aux données sur les impacts environnementaux et aux dépenses budgétaires en temps réel réduit systématiquement la perception de corruption.
Un auteur engagé sur ce sujet a souligné l’importance de la transparence pour établir la confiance à travers une gouvernance honnête et accessible, dans un monde socialement et politiquement complexe :
4/ That's on top of Trump's imposition of secondary sanctions on Russia's customers.
— Rod D. Martin (@RodDMartin) August 21, 2025
Russia can't fight without cash. Trump has made clear he'll dry that up. He's already started with India.
Putin needs to think very carefully. He can have peace. Or he can bleed. pic.twitter.com/0hx4nomxV4
L’avenir de la transparence comme impératif démocratique
Gouverner en 2025 repose sur un principe fondamental : la confiance ne se décrète pas – elle se construit par l’ouverture, la prévisibilité et la responsabilité. Face à des défis comme la résilience climatique ou la régulation de l’intelligence artificielle, les institutions publiques doivent s’adapter aux besoins d’une population de plus en plus informée et connectée.
La transparence n’est plus une question secondaire, elle constitue l’ossature même de la légitimité publique. La manière dont les gouvernements renforcent cette transparence façonnera non seulement leurs résultats internes, mais aussi leur crédibilité à l’échelle internationale. Plus la confiance s’érode, plus la transparence devient essentielle – non pas pour embellir l’image, mais pour préserver la démocratie elle-même.